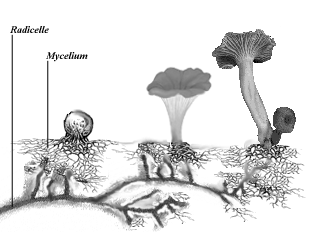
La reproduction des champignons
À la demande d'un certain nombre de personnes j'ai réalisé cette partie du site qui est une initiation à la reproduction des champignons.Les Champignons (mycètes) ne font pas partie des végétaux. Au contraire, les Champignons ont plus de caractéristiques en commun avec les animaux qu'avec les végétaux (voir l'arbre du vivant).
Entre autres points communs, ils ne peuvent pas utiliser la lumière, contrairement aux végétaux qui "s'alimentent" grâce aux sels minéraux du sol et au dioxyde de carbone pour fabriquer leur matière organique. Les champignons se nourrissent (comme les animaux) de matière organique préexistante.
Les ascomycètes : truffes,
morilles... se reproduisent par des spores
qui mûrissent dans des sacs appelés asques
(en général à 8 spores).
Les basidiomycètes : amanites, cèpes... se reproduisent par des spores portées par les basides qui ont une forme de massue. Ces spores sont supportées à l'extrémité des stérigmates (petits tubes porteurs), et elles sont le plus couramment au nombre de 4.
Voir aussi : Explications sur le groupe BASIDIOMYCOTINA
La reproduction :
Le
champignon se reproduit par des spores minuscules de l’ordre
en
moyenne d’un centième de millimètre ; les spores à maturité sont
dispersées par
le vent et le ruissellement de l’eau. Une partie infime des spores va
germer en
donnant des filaments qui se différencient par des polarités
différentes
(nommées + et -). Ces filaments très fins en réseau constituent le mycélium primaire.
La rencontre de
deux mycéliums primaires
de polarités différentes formera après fusion un mycélium
secondaire d'où naîtra ce qu'on appelle dans le langage
courant un
champignon. Cette structure éphémère sortant du sol, dont le rôle est
de
disséminer les spores, n'est en fait que la partie visible du
champignon, le sporophore
(littéralement
« porte-spores »).
Les spores ne
sont pas exactement des graines, elles ont simplement en
commun avec les graines des plantes d'être des organes
de dissémination pour la conquête de nouveaux milieux.
Mais leur structure
et leur mode de formation
dans le cycle de reproduction sont différentes.
Les
mycorhizes
La grande
majorité des champignons vit en étroite collaboration avec des
végétaux terrestres. Ils sont en symbiose
(association à bénéfices réciproques) avec les filaments mycéliens qui
engainent les fines racines (radicelles)
Cette symbiose
avec la plante forme une mycorhize (de
myco :
champignon
et rhiza : racine).
Certaines graines
d'orchidées ne germent pas dans un sol stérile, sans
champignons.
Une
animation sur le développement d'un champignon
La présence de
Mycorhizes sur les radicelles :
-augmente la
surface du réseau racinaire ce qui engendre une
meilleure absorption de
l’eau par la plante en
période sèche
-renforce la
lutte de la plante contre les maladies
-apporte des
minéraux à la plante
-stabilise le sol
par le réseau mycélien
-accélère la
croissance des plantes
Le champignon va
fournir des éléments minéraux de la rhizosphère (généralement définie comme la région du sol sous influence de la racine) aux espèces
végétales et
ainsi améliore leur
nutrition.
Il existe
d’autres types de relations :
Les champignons
saprophytes :
Ils s'attaquent à
la matière organique morte : humus, bois, fruit,
cadavre, ils digèrent tout, et participent au nettoyage de la forêt.
Les champignons
parasites :
Il suffit d’une
blessure sur l’arbre ou une faiblesse suite à une
sécheresse pour qu'ils s'installent. Ils pénètrent dans les cellules,
s'attaquent aux tissus vivants, et y puisent tout ce dont ils ont
besoin, ce
qui entraîne la mort de leur hôte.
On peut dire un
mot sur un champignon appelé Cordyceps militaris
qui s’attaque à des insectes : chenilles ou chrysalides vivantes,
pendant leurs
transformations. Il les recouvre de mycélium et les vide de leurs
substances
jusqu'à la mort de l’insecte.
Les
mythes :
Les champignons
poussent même, quelques fois, dans les champs ou en
forêt en cercle presque parfait ; ce phénomène porte le nom de
ronds de
sorcières ou cercle de fées. Selon de nombreuses légendes du Moyen Âge,
ils
étaient associés avec les forces du mal.
A cette époque,
on ne connaissait pas le microscope, ces choses
maléfiques pour eux ne possédaient pas de graines pour se reproduire et
sortaient de terre en une nuit.
Ces ronds de
sorcières lié à un
mycélium annulaire
s’élargit de quelques centimètres jusqu'à un mètre chaque année pour
certaines
espèces pour mycorhizer d’autres plantes et récupérer les
substances
nutritives du sol. On peut même repérer ces cercles
par une herbe d'un
vert plus foncé dans les prairies, hors période
de fructification. Le
Tricholome de la Saint-Georges (Calocybe
gambosa)
fait partie de ces espèces.
Au Canada, on a
observé des cercles vus d’avion jusqu'à 3 km de
diamètre.